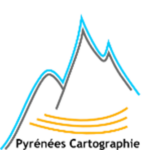Depuis 2023, le Syndicat Mixte du Massif des Maures, l’ASL Suberaie Varoise, le CNPF, l’ONF et le SPCV travaillent en étroite collaboration sur un projet européen (FEADER) visant à faciliter « La mobilisation de ressources forestières à haute valeur ajoutée sur le Massif des Maures ».
Ce projet européen s’inscrit dans les stratégies locales de développement pour la gestion de la forêt et a pour objectifs de « Développer une gestion forestière dynamique et durable » (Charte Forestière du massif 2022-2030, axe 1). Il s’agit d’agir sur la déprise forestière qui accroît les risques naturels et provoque la fermeture des milieux naturels.
Pour cela le SMMM et ses partenaires veulent s’attacher à :
- Diminuer les coûts de transports liés à une desserte difficile, en élaborant un schéma de desserte qui permettra aux acteurs publics de planifier des travaux de récolte de bois sur les années à venir dans le massif ;
- Mieux appréhender la ressource disponible en produits forestiers à hautes valeurs ajoutées, en particulier le liège, le pin d’Alep destiné au bois d’œuvre et le bois de châtaignier.
Les partenaires souhaitent, à travers ce projet, renforcer le partenariat public-privé afin d’améliorer la connaissance des ressources en bois mobilisables et de coordonner les actions de repérage jusqu’ici isolées.
Le Syndicat a mandaté un groupement de bureaux d’études pour travailler sur un projet d’amélioration de la desserte forestière. Après avoir recueilli toutes les informations auprès des partenaires forestiers sur la disponibilité de la ressource en bois, le groupement a travaillé sur l’identification des points noirs (zone qui ne permettent pas le passage de camions-grumiers) par bassin de récolte.
Un premier atelier de travail et une visite de site ont été planifiés le 12 avril 2024 afin de mieux appréhender ses difficultés en associant partenaires forestiers et partenaires institutionnels. Un second atelier de travail s’est tenu le 11 juin 2024 , en présence de certains élus, pour présenter les premières conclusions du schéma de desserte et permettre des échanges avant finalisation du dossier.
Principaux résultats : Au total, 26 points noirs ont été identifiés à l’échelle du massif des Maures: essentiellement des reprises de virage et passage busé, auxquelles s’ajoutent des élargissements de bande de roulement à prévoir dans le cadre des travaux de défense incendie.
Enfin, les deux structures ont travaillé pendant l’hiver sur la mobilisation des propriétaires forestiers (privés et publics), avec 4 réunions publiques organisées dans les communes subéricoles par le Syndicat Mixte du Massif des Maures et l’ASL SV, 3 réunions spécifiques organisées par les techniciens de l’ONF auprès des élus communaux, 2 réunions spécifiques organisées auprès des communautés de communes – maître d’ouvrage PIDAF pour le lien entre les travaux PIDAF et les levées de liège et la subériculture en général – 1 Visite de site organisée par le Syndicat Mixte du Massif des Maures, l’ONF, le CNPF et l’ASL SV auprès des élus, partenaires et propriétaires privés le 3 juillet 2024 sur la commune des Mayons.L’ASL SV et l’ONF travaillent de concert pour mettre à jour la cartographie des suberaies à l’échelle du massif des Maures. Cette cartographie est doublée d’un travail de terrain pour appréhender la qualité des suberaies et permettre de définir les zones d’exploitation possible pour le liège.
Principaux résultats : Les prospections de terrain ont permis de décrire selon le protocole mis en place, sur environ 45 000 hectares de suberaies dans le massif des Maures, une superficie de 8 800 ha environ de suberaies privées et 6 200 ha environ de suberaies publiques ayant un potentiel pour l’exploitation de liège.
Au-delà de cette cartographie, l’ASL SV et l’ONF ont organisé deux journées de montée en compétences des acteurs forestiers sur le territoire. La première journée, programmée par l’ASL SV, s’est déroulée le 30 novembre 2023 au Château Galoupet et a permis d’échanger sur les méthodes pour évaluer l’état sanitaire des peuplements face au changement climatique. Une seconde journée de montée en compétence a été organisée par l’ONF sur une ancienne plantation INRAE de chêne liège, le 23 avril 2024.
Enfin, les deux structures ont travaillé pendant l’hiver sur la mobilisation des propriétaires forestiers (privés et publics), avec 4 réunions publiques organisées dans les communes subéricoles par le Syndicat Mixte du Massif des Maures et l’ASL SV, 3 réunions spécifiques organisées par les techniciens de l’ONF auprès des élus communaux, 2 réunions spécifiques organisées auprès des communautés de communes, maître d’ouvrage PIDAF pour le lien entre les travaux PIDAF et les levées de liège et la subériculture en général, 1 Visite de site organisée par le Syndicat Mixte du Massif des Maures, l’ONF, le CNPF et l’ASL SV auprès des élus, partenaires et propriétaires privés le 3 juillet 2024 sur la commune des Mayons.
Le Pin d’Alep, aussi appelé Pin blanc de Provence, est l’essence la plus adaptée face au changement climatique : il est autochtone, pionnier et peut pousser sur des sols très superficiels (comme les calanques de Cassis), mais dispose d’une mauvaise image car très incendiaire et peu valorisable (produit bas de gamme).
Pourtant, une réglementation récente (2018) permet de le valoriser en bois d’œuvre. L’objectif de cette action est donc de permettre une montée en compétence du territoire sur cette essence.
De même que pour le liège, l’ONF et le CNPF travaillent sur l’établissement d’une cartographie des peuplements de Pin d’Alep à l’échelle du territoire.
Principaux résultats : Pour la forêt publique relevant du régime forestier (forêts domaniales et communales), le Pin d’Alep représente environ 1 400 ha sur l’unité territoriale des Maures (hors Roquebrune et le Muy), c’est à dire environ 5% du territoire forestier public. Pour la forêt privée, ce sont environ 7 500 ha qui ont été répertoriés, dont 1000 ha environ inclus dans un Plan Simple de Gestion et 270 ha prévus en coupe dans les vingt prochaines années. Les principales communes présentant du Pin d’Alep sont Cuers, Le Luc, Le Cannet-des-Maures, Pignans et Puget-ville.
Des campagnes de repérage ont été réalisées en forêt publique pour affiner la connaissance de la ressource disponible. 53 sites ont fait l’objet d’une reconnaissance de terrain entre janvier et fin avril 2024. Les données collectées sur le terrain pour les 53 sites ont été couplées aux états d’assiette pour les 10 prochaines années en forêt publique pour permettre d’estimer la quantité de bois valorisable en bois d’œuvre. Les chiffres sont assez faibles et montrent toute l’importance de mener une sylviculture adaptée pour permettre une meilleure valorisation suite au changement de norme de 2018.
Ainsi, au-delà de la cartographie et du travail de terrain, des formations ont été organisées par l’ONF pour permettre d’améliorer la sylviculture du Pin d’Alep auprès des gestionnaires publics et privés et de réaliser des reconnaissances sur pied des arbres valorisables en bois d’œuvre (pendant l’hiver 2023-2024).
L’action relative à la gestion et valorisation des ressources ligneuses castanéicoles (châtaignier) vise à diminuer le brûlage des rémanents (branches au sol) en forêt.
D’une part, le brûlage détruit de la matière organique qui pourrait être bénéfique pour les sols et d’autre part, en raison du risque incendie. Les périodes autorisées de brûlage sont de plus en plus courtes et ces résidus qui restent plus longtemps sur les parcelles, en attendant de pouvoir être brûlés, accroît la quantité de combustible dans le massif.
Le programme vise à trouver des alternatives, soit en broyant les rémanents, soit en valorisant les bois.
Principaux résultats : sur le premier point (broyage), des actions ont été menées pour comprendre quels types de broyeurs seraient adaptés aux terrains en pente et peu accessible aux châtaigneraies. Des actions de sensibilisation ont été menées auprès des castanéiculteurs (conférences) pour les sensibiliser à la problématique de brûler en forêt et à l’intérêt de broyer, lorsque possible. Cependant, l’accès et la configuration en pente ou en terrasse des châtaigneraies ne permettent pas toujours de mettre en place cette technique. Il faut noter que certaines communautés de communes du territoire mettent néanmoins à disposition des broyeurs pour leur résidents.
Sur la valorisation du bois de châtaignier, des initiatives locales perdurent à travers la vannerie, certaines menuiseries, etc. Certains paysagers se montrent intéressés pour travailler le bois de châtaignier pour des aménagements paysagers. Enfin, la mise en fascine peut également être un débouché pour certaines parcelles. L’association Permabita s’est investie aux côtés du SPCV et de l’ASL SV pour tenter de trouver des débouchés sur certaines parcelles test, pour valoriser ces bois en piquet de châtaignier, bois d’ornement ou bois d’œuvre. Une conférence a également été organisée pour échanger sur ces sujets avec les castanéiculteurs et permettre une mise en réseau des différents acteurs.
Cet axe contenait essentiellement la coordination des actions, mais également des points complémentaires comme la recherche de sites et bâtiments publics pilotes pour valoriser les ressources forestières du Massif des Maures, les évaluations environnementales des différents projets, la conciliation des projets avec tous les usages du massif et la mobilisation des élus des communes et intercommunalités pour les associer à la démarche.
Principaux résultats : En ce qui concerne la recherche de sites et bâtiments publics pilotes pour valoriser les ressources forestières, le Syndicat s’est attaché à rechercher du foncier pour permettre de dynamiser les initiatives locales et les associations qui travaillent sur la transformation du bois. Différentes pistes ont été explorées et sont toujours en cours. Cette initiative vient renforcer l’action du Syndicat au niveau de la desserte forestière, qui doit permettre de trouver des débouchés locaux pour l’exploitation forestière.